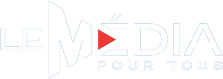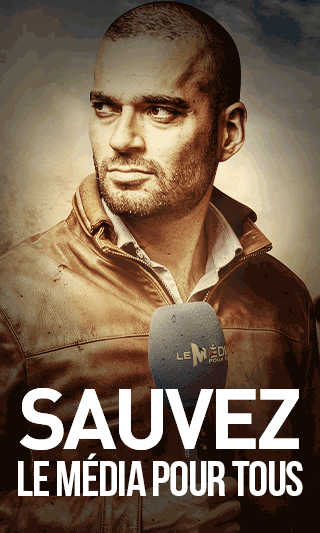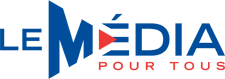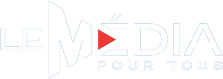Lorsque j’ai franchi la grille Thayer de West Point – embrassant ma carrière militaire – il y a eu 20 ans le mois dernier, l’Amérique n’était pas en guerre. Pas réellement en tout cas. À l’époque, lorsque la mère d’un jeune de 17 ans signait son engagement dans l’armée (ce qu’elle devait alors faire), il pouvait s’attendre à une mission de maintien de la paix au Kosovo ou, au pire, à une malheureuse bataille de rue en Somalie ou à une guerre terrestre biaisée de 100 heures dans le Golfe. Bien plus excitant, il pouvait espérer des aventures à l’étranger avec des filles allemandes, sud-coréennes – ou même carrément, des filles du Kentucky.
Puis tout a changé.
Deux mois et dix jours plus tard, ma section de cadets épuisés faisait du shadowboxing devant des miroirs muraux dans le gymnase Arvin – dans ce qui doit être le seul cours de pugilat obligatoire pour les étudiants de première année du pays – lorsque quelqu’un est entré en courant, criant quelque chose à propos des tours jumelles du World Trade Center et d’un accident d’avion. Le reste de la matinée – et franchement les deux décennies suivantes – restent floues. Ce jour-là, cette semaine, ce mois-là et cette année-là, on parlait déjà de guerre avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi avec beaucoup d’anxiété. Nous avons eu la guerre que nous attendions – enfin, que nous voulions à moitié – mais elle s’est transformée en quelque chose de plus grand et de plus vaste que ce que nous, adolescents guerriers, aurions pu imaginer.
Les représailles (apparemment) évidentes des Afghans ont été rapidement éclipsées par l’invasion et l’occupation sanglante et interminable de l’Irak. Très vite, les diplômés et rivaux au football de l’Air Force et de la Naval Academy ont également bombardé et bloqué le Pakistan, le Yémen, la Libye, la Somalie, la Syrie et le Sahel africain. Sous ces bombes, des soldats de l’armée de Terre tuaient et mouraient dans nombre de ces endroits – dont certains, comme le Niger, ne pouvaient probablement pas être prononcés par plus de 5 % des Américains… et encore moins localisés sur une carte.
Lors de ma première et de ma dernière année à West Point, il n’était pas rare de commencer les matinées obligatoires dans les mess par des moments de silence – tandis qu’un haut-parleur annonçait le nom d’un autre diplômé tué au combat. Le 28 mai 2005, les membres de ma propre classe ont revêtu leurs nouvelles barrettes de lieutenant. Par coïncidence, nous étions exactement 911 diplômés et nous avons fait la couverture de Time Magazine en étant surnommés « la classe du 11 septembre ». En l’espace de 18 mois, quelque 70 % d’entre nous étaient, ou avaient été, à la guerre non pas en Afghanistan – mais dans un Irak qui n’avait absolument aucun rapport avec les attaques du 11 septembre. Depuis lors, huit de mes camarades de classe ont été tués, quelques-uns se sont suicidés, et bien plus encore ont été blessés, dans des guerres que notre génération de candidats officiers ne s’attendait pas à devoir mener le 2 juillet 2001.
Déploiement et morts, selon les chiffres
Les statistiques confirment ces vagues souvenirs. La répartition et le déploiement du personnel de l’armée en service actif dans le monde entier étaient radicalement différents au moment des attentats du 11 septembre 2001 – et donc, les perspectives pour un soldat en herbe aussi. Voici quelques faits saillants faciles à juxtaposer – et qui font frémir :
En septembre 2001, 378 240 soldats actifs (78,5 % de l’ensemble) se trouvaient aux États-Unis et dans ses territoires ; 68 640 d’entre eux (14,3 % supplémentaires) étaient en Europe ; 30 841 soldats (6,3 %) étaient (relativement) en sécurité en Corée du Sud ou au Japon. Seuls 2 945 membres de l’armée active (un peu plus d’un demi pour cent) étaient déployés en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie du Sud – dont plus des deux tiers dans la zone de non-combat du Koweït – et un nombre statistiquement insignifiant de 46 étaient en Afrique subsaharienne.