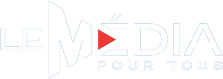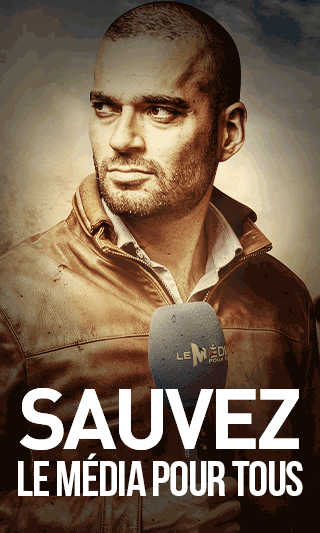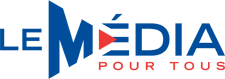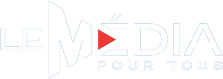Dans ses conclusions, la Défenseure des droits Claire Hédon, en poste depuis juillet 2020, alerte sur le fait que l’usage de ces drones risque de dissuader des personnes voulant manifester, de crainte d’être filmées, alors qu’il s’agit d’une liberté publique protégée constitutionnellement. Même son de cloche chez Amnesty International.
Cette semaine, l’Assemblée nationale débat autour du projet de loi sur la responsabilité pénale et la responsabilité intérieure. Promulgué officiellement pour répondre à l’émotion causée par l’affaire Sarah Halimi, ce texte renferme en fait un arsenal de mesures sécuritaires dont certaines avaient été censurée par le Conseil Constitutionnel dans le cadre la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Parmi ces mesures : l’autorisation de la surveillance policière par drone, pourtant retoquée à plusieurs reprises par le Conseil d’État durant les confinements. Les associations et la Défenseure des droits dénoncent une atteinte au droit à la vie privée et un outil de répression sans garde-fou.
La bataille des drones policiers
Il a tenu sa promesse. Au lendemain de la censure du Conseil constitutionnel de l’utilisation des drones par les forces de l’ordre, Gérald Darmanin avait déclaré dans le Parisien qu’il trouverait un moyen de faire voler des drones « extrêmement efficaces dans la lutte contre la drogue, les rodéos motorisés et la maîtrise de l’ordre public.
Exfiltrés de la loi Sécurité globale, les caméras aéroportées, et notamment les drones, reviennent donc discrètement dans l’article 8 du projet de loi sur l’irresponsabilité pénale.
Pour éviter une nouvelle censure, Beauveau a soigneusement modifié quelques lignes du texte pour donner à la vidéosurveillance aéroportée un semblant de cadre juridique pérenne.
S’il y a bien quelques améliorations, comme la réduction de la durée de conservation des données et l’interdiction de traiter les images par drone avec des logiciels de reconnaissance faciale, les modifications restent tout de même marginales.